Face à des affirmations fausses, difficile d’affirmer quelle serait la réalité sans verser à son tour dans le simplisme et le dogmatisme… Quelles réponses la philosophie apporte-t-elle à ce problème ? Faut-il diaboliser les fausses informations, ou mettre en dialogue toutes les croyances et idées ?
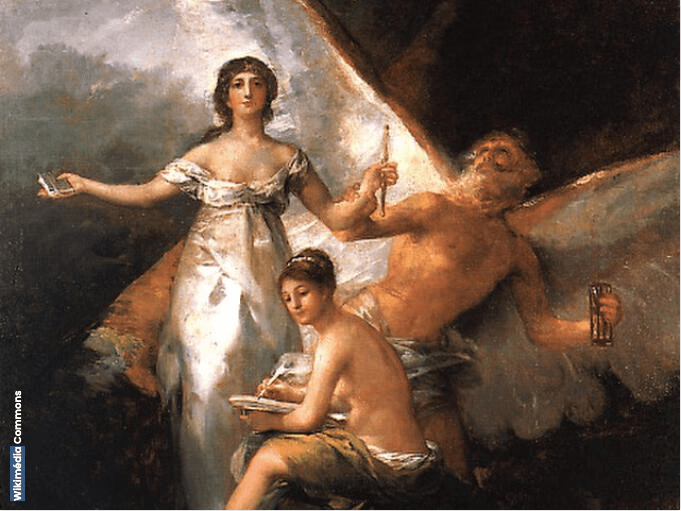
Cet article paru sur le site de Lumni Enseignement. Rendez-vous sur le site pour en savoir plus.
L’île Norfolk, dans le sud-ouest de l’océan Pacifique, n’est pas un dangereux concurrent pour les États-Unis. Seulement habitée par quelque 2 000 personnes et sans aucun rayonnement économique, ce territoire a pourtant été frappé de 29 % de droits de douane – contre 10 % pour le reste de l’Australie à laquelle elle est rattachée. Ce n’est pas la seule bizarrerie de la guerre commerciale initiée par Donald Trump en avril 2025 : des zones inhabitées, recouvertes de glaces ou peuplées uniquement de pingouins ont aussi subi des augmentations record, tandis que le calcul économique utilisé par la Maison Blanche s’est avéré contenir d’importantes erreurs – confondant, par exemple, le déficit commercial avec le niveau de droits de douane. Autant de signes que les décisions prises avec aplomb par l’imprévisible président américain étaient déconnectées de la réalité ; tant et si bien que son ambitieuse réforme a été, mercredi 5 novembre 2025, contestée par un juge fédéral qui a estimé fallacieuse l’utilisation, pour la justifier, d’un texte d’urgence économique datant des années 1970.
Donald Trump et les « faits alternatifs »
Depuis sa première campagne et son élection en 2017, le 45e, et désormais 47e président des États-Unis a multiplié les « faits alternatifs ». L’expression a d’ailleurs été inventée par l’une de ses conseillères, Kellyanne Conway, pour relativiser un mensonge de campagne. Ces « faits alternatifs » seraient selon elle la preuve qu’il est impossible de parler d’une seule et même réalité comme fondement d’une vérité indiscutable. Cette notion attaque ce qui constitue la définition de la « vérité-correspondance » (voir encadré) : comment en effet parler d’une vérité quand on ne s’accorde pas sur une vision de la réalité ?
Avec le Covid-19, une épidémie de mensonges
Les États-Unis n’ont pas l’exclusivité des fausses déclarations, déformations et approximations dans le débat public. L’épidémie de Covid-19 a servi de terreau à de nombreuses théories alarmistes et mensongères un peu partout dans le monde : les vaccins serviraient à injecter des puces 5G, modifieraient l’ADN des vaccinés, seraient plus dangereux que la maladie combattue… Autant d’affirmations déconnectées de la réalité, scientifique en particulier. Force est cependant de reconnaître que, dans le climat confus de la pandémie, des représentants politiques et des scientifiques ont tenu des propos contradictoires, pouvant susciter le doute vis-à-vis des institutions – par exemple, sur l’efficacité des masques, des confinements, ou encore sur l’origine du virus. Outre les débats sur l’hydroxychloroquine, promue comme traitement par le microbiologiste Didier Raoult alors que son efficacité était plus que douteuse, des responsables politiques comme Agnès Buzyn ou Édouard Philippe, respectivement ministre de la Santé et Premier ministre, ont minimisé l’intérêt des masques chirurgicaux, avant de finalement les rendre obligatoires !
Faut-il dire la vérité en politique ?
L’idée que les hommes ou les femmes politiques peuvent mentir, voire qu’ils y sont contraints, s’inscrit dans une longue histoire philosophique. L’un des premiers théoriciens modernes de la stratégie politique, Nicolas Machiavel, estime en 1532 dans Le Prince (chapitre 18 notamment) que les gouvernants doivent dissimuler des faits, leurs intentions et même mentir si cela leur permet de conserver le pouvoir et de parvenir à leurs fins.
À la fin du XVIIIe siècle, une controverse devenue classique oppose le député français Benjamin Constant et le philosophe Emmanuel Kant. Pour le premier, les responsables politiques bénéficient d’un droit de mentir si cela permet d’éviter des conséquences néfastes. Si un assassin frappe à votre porte et que vous cachez la personne qu’il veut tuer, vous en avez même le devoir.
« Dire la vérité n’est donc un devoir qu’envers ceux qui on droit à la vérité. Or, nul homme n’a droit à la vérité qui nuit à autrui » (Benjamin Constant)
Kant lui répond directement (mais sans le nommer) dans un essai intitulé Sur un prétendu droit de mentir par humanité (1797) :
« Dire la vérité est un devoir, même envers celui veut porter atteinte à la vie d’autrui » (Emmanuel Kant)
Fidèle à son rigorisme, Kant conteste que le mensonge puisse entrer dans une catégorie telle que « le droit » ou « le devoir » ; il est toujours immoral et illégitime à ses yeux.
Aujourd’hui, le débat reste ouvert mais beaucoup d’analystes soulignent que, de fait, les hommes et les femmes politiques manient régulièrement de fausses informations dans le débat public. Comme l’écrivait la philosophe Hannah Arendt dans La Crise de culture (1961) :
« Le résultat d’une substitution cohérente et totale de mensonges à la vérité de fait n’est pas que les mensonges seront maintenant acceptés comme vérité, ni que la vérité sera diffamée comme mensonge, mais que le sens par lequel nous nous orientons dans le monde réel – et la catégorie de la vérité relativement à la fausseté compte parmi les moyens mentaux de cette fin – se trouve détruit. » (Hannah Arendt)
Autrement dit, le problème n’est pas tant de mentir – car c’est encore reconnaître qu’une vérité existe par ailleurs… –, c’est d’abolir toute distinction entre le vrai et le faux, et de perdre ainsi complètement de vue la réalité.
Comment contrer les discours complotistes ?
Dans ce contexte, n’y a-t-il pas un risque à dénoncer comme « complotiste » le fait de douter de vérités établies ou de remettre en question des discours officiels ? Dans Les Sciences dans la mêlée (Seuil, 2023), les philosophes Bernadette Bensaude-Vincent et Gabriel Dorthe préconisent de rompre avec cette position de surplomb : les choses ne sont jamais simples ; les expertises de toute sorte peuvent aussi avoir leurs faiblesses – elles sont engagées dans des controverses, perméables à des biais idéologiques… Et le doute, même radical, s’avère parfois plus fructueux que le culte de l’objectivité et du progrès. Ces auteurs proposent en conséquence de valoriser une « culture de la défiance » et du débat, ne cherchant plus tant à hiérarchiser les croyances et idées qu’à les mettre en dialogue. Quelques années plus tôt, le physicien et philosophe français Étienne Klein a défendu une position antagoniste dans Le Goût du vrai (Gallimard, 2020) : pour lui, le doute méthodique est certes inhérent à la démarche rationnelle et scientifique, mais il n’est qu’une étape dans une pensée qui, en définitive, devrait rester guidée par le souci de chercher et de défendre la vérité.
La vérité, entre scepticisme et dogmatisme
Cette opposition paraît aussi ancienne que la philosophie elle-même. Dans l’Antiquité grecque, la figure tutélaire de Socrate (Ve s. av. J.-C.) est ambivalente : d’un côté, il semble avoir professé un scepticisme radical : cette position consiste à remettre systématiquement en question les opinions de nos interlocuteurs, le bien-fondé des lois, règles et usages de notre temps, ou encore les institutions et personnalités au pouvoir. Cette démarche socratique a influencé des écoles de philosophie très critiques des concepts de « vérité » et de « réalité », comme le scepticisme, le cynisme ou encore le relativisme. « L’homme est la mesure de toutes choses » aurait par exemple déclaré le sophiste Protagoras. Autrement dit, rien n’aurait de réalité objective en dehors du sujet, de chaque individu percevant le monde. D’un autre côté, Socrate a aussi inspiré des écoles philosophiques dites « dogmatiques » – sans que le terme ne soit péjoratif, dans le sens où elles admettent certaines idées ou énoncés comme absolument vrais. Dans les dialogues de Platon, rédigés après la mort de Socrate, ce disciple particulièrement influent souligne ainsi l’attachement de son maître à la rationalité et à la vérité. Pour lui, comme plus tard pour les philosophes aristotéliciens, stoïciens ou encore épicuriens, certaines croyances et affirmations sont plus proches de la réalité que d’autres. Et nous pouvons les vérifier ou les infirmer, en adoptant des méthodes que l’on qualifierait aujourd’hui de scientifiques.
Vérité, christianisme et islam
L’influence de Platon et d’Aristote est restée majeure à travers le monde. En Occident, les premiers chrétiens se sont approprié une grande partie de leurs thèses, qui avaient souvent l’avantage d’être compatibles avec la vision dominante du monde et de Dieu. Tout au long du Moyen Âge, cette philosophie grecque est aussi abondamment traduite dans le monde musulman, où elle influence des figures tutélaires de la philosophie arabe et indienne, comme Al-Fârâbî (v.872-950), Avicenne (980-1037) ou encore Averroès (1126-1198).
Quelques grands principes dogmatiques semblent s’être ainsi imposés dans l’imaginaire collectif : les apparences sont souvent trompeuses, mais il est possible et préférable de chercher à établir la vérité. Si l’on procède avec rigueur, on peut en effet montrer qu’une cause entraîne toujours le même effet, qu’une ligne droite est nécessairement le plus court chemin d’un point à un autre, ou qu’une éclipse de Soleil se produira à telle ou telle date. Plusieurs facteurs peuvent expliquer le succès de cette conception de la connaissance. D’une part, la notion classique de « vérité » était souvent au cœur de dogmes religieux, qu’il était difficile voire interdit de remettre en question. D’autre part, la démarche scientifique portait ses fruits dans toute une série de disciplines, comme la médecine, l’architecture ou encore l’agriculture.
À l’époque moderne (1453 -1789) toutefois, la science s’est progressivement émancipée de sa tutelle religieuse, permettant l’essor de révolutions scientifiques comme la physique galiléenne ou la théorie darwinienne de l’évolution. Bénéficiant du recul des autorités religieuses, les philosophies sceptiques et relativistes ont du même coup pu revenir sur le devant de la scène.
Nietzsche, Freud et Marx : les maîtres du soupçon
« Ce n’est qu’un préjugé moral de croire que la vérité vaut mieux que l’apparence. C’est même la supposition la plus mal fondée qui soit au monde. » (Friedrich Nietzsche)
Cette déclaration de guerre à la philosophie de la connaissance, dans Par-delà bien et mal (1886), résume bien une nouvelle forme de scepticisme à l’époque contemporaine. Dans Le Conflit des interprétations (1969), le philosophe français Paul Ricœur évoque plus généralement l’influence de trois « maîtres du soupçon » : Nietzsche, Freud et Marx. Chacun à sa façon, explique Ricœur, ils estiment que nous sommes traversés par des influences qui nous dépassent et dont nous avons rarement conscience. Celles-ci biaisent notre représentation des choses et rendent pour ainsi dire impossible l’accès à une réalité. Pour eux, en outre, ce que l’on appelle communément la « vérité » serait le masque de rapports de forces – politiques, sociaux, idéologiques… – et d’un système de domination s’efforçant de bloquer toute forme de critique en brandissant ce concept. Cette philosophie, que l’on qualifie parfois aussi de « postmoderne », fait de nombreux émules jusqu’à aujourd’hui. En France, des philosophes et écrivains comme Albert Camus, Gilles Deleuze ou encore Michel Foucault ont largement contribué à sa popularité.
Elle est en retour sévèrement critiquée par des chercheurs attachés à la démarche scientifique, comme Jacques Bouveresse. Tout au long de sa carrière, ce spécialiste du philosophe autrichien Ludwig Wittgenstein (1889-1951) dénonce une approche jugée littéraire et artistique de la philosophie, pouvant procéder à des analogies stimulantes ou politiquement séduisantes, mais ne disant finalement rien de très concret.
Il faut dire que le débat avait suivi une autre voie chez les philosophes des sciences, suite notamment à l’essor de la pensée de Wittgenstein en Europe. Pour l’école du cercle de Vienne, fondée en Autriche dans les années 1920, des observations empiriques peuvent être confirmées et être du même coup considérées comme des faits scientifiques. Si on dit qu’un objet lancé à telle vitesse et dans telle direction atteindra une destination préétablie, il est possible de vérifier cet énoncé en réalisant l’expérience. Le philosophe britannique d’origine autrichienne Karl Popper (1902-1994) fait école en nuançant cette idée : pour lui, il est plus juste de dire que certaines croyances peuvent être réfutées, dans le sens où nous pouvons tester des contre-exemples – théorie dite de la « falsifiabilité » des hypothèses. Prenons un exemple simple : une personne affirme que manger régulièrement des bonbons protège contre les attaques de spectres. Cet énoncé est infalsifiable, dans le sens où il est impossible d’imaginer une situation où il serait faux : si vous êtes gourmand, on dira que c’est la raison pour laquelle vous n’êtes pas attaqués ; et si vous êtes plus raisonnable, on répondra que vous avez eu la chance de ne jamais croiser de spectre… Pour Popper, cette affirmation ne peut donc pas être considérée comme une théorie scientifique. Il faudrait pouvoir exposer quelqu’un de gourmand à un spectre et vérifier s’il se fait tout de même attaquer… Ce type d’expérience ne rend jamais nos connaissances certaines, précise Popper, mais c’est un gage de fiabilité.
Ces courants de pensée s’inscrivent le plus souvent dans une vision héroïque de la science, décrivant les recherches comme un progrès constant. La Seconde Guerre mondiale met néanmoins un coup d’arrêt à cette idée : l’horreur des expériences nazies ou encore les bombardements nucléaires du Japon par les États-Unis bouleversent la communauté scientifique internationale et remettent en question leurs idéaux.
Kuhn et le « changement de paradigme »
Pour cette raison, peut-être, la seconde moitié du XXe siècle connaît un retour spectaculaire du relativisme. Dans La Structure des révolution scientifiques (1962), l’Américain Thomas Kuhn estime que l’histoire des sciences ne peut pas être décrite comme un mouvement de progrès vers plus de vérité. Si c’était le cas, explique-t-il, chaque nouvelle théorie ne ferait que compléter les précédentes ; or ce n’est pas du tout ce que l’on observe. Lorsque Copernic puis Galilée proposent une nouvelle vision de l’astrophysique, où la Terre n’est plus au centre de l’Univers, ils ne se contentent pas d’amender l’ancienne théorie de Ptolémée. Ils inventent de nouvelles méthodes scientifiques et construisent des objets – le Soleil, les étoiles… – qui n’ont plus rien à voir avec ce que ces mêmes mots désignaient auparavant. C’est ce que Kuhn appelle « l’incommensurabilité » des théories. Et pour lui, décréter qu’un modèle est supérieur à l’autre serait présomptueux, il est plus juste de parler d’un « changement de paradigme » ou de modèle dominant. Des chercheurs réunis autour de Karl Popper lui répondent en mobilisant notamment une objection classique : dire que toutes les théories se valent serait toujours contradictoire, puisque l’on affirme en même temps la supériorité de la thèse relativiste… Kuhn finit de fait par atténuer ses positions, en reconnaissant par exemple que les théories physiques les plus récentes expliquent davantage de phénomènes, de façon plus simple, logique et consistante. Pour autant, il ne cesse jamais de mettre en garde contre la vision traditionnelle d’un supposé progrès des connaissances.
Limites du relativisme
Dans les années 1970 et 1980, la controverse se développe autour du concept de « normes épistémiques » et « non épistémiques ». Dans la lignée de Kuhn, le philosophe des sciences autrichien Paul Feyerabend plonge dans l’histoire de la révolution copernicienne et constate qu’elle ne peut pas être réduite à un progrès des connaissances. À l’époque de Copernic et de Galilée (aux XVIe et XVIIe siècles), le modèle héliocentrique (qui place le Soleil au centre de l’Univers) n’apportait pas encore de prédictions sensiblement meilleures que le « vieux » modèle géocentrique, et restait contre-intuitif. Si le nouveau modèle a fini par s’imposer, estime Feyerabend, c’est en partie pour des raisons sociales, politiques ou idéologiques – en lien notamment avec la remise en cause de la toute-puissance ecclésiastique par les tenants de la Réforme et le mouvement des grandes découvertes. Le sociologue des sciences Bruno Latour (1947-2022) parvient à des conclusions similaires en étudiant la découverte des microbes par Louis Pasteur : faute de microscopes adaptés à l’époque, l’existence de ces micro-organismes restait controversée. Pasteur a dû aussi engager un débat politique et social pour promouvoir une nouvelle vision du monde vivant. Ce type de recherches historiques consacre une forme de « relativisme d’atmosphère » dans la communauté scientifique. Tous les chercheurs admettent désormais que des normes non épistémiques (lire l’encadré ci-dessous) influencent la production de connaissances. Le fait, par exemple, qu’on choisisse d’étudier tel ou tel sujet, ou que l’État investisse de l’argent public dans certains secteurs au détriment des autres, s’avère déterminant sans que ce ne soit lié à des critères purement scientifiques.
Pourtant, la marche des sciences se réduit-elle à des débats politiques et sociaux ? Des chercheurs comme Michel Foucault, Paul Feyerabend ou encore David Bloor sont allés très loin dans le relativisme. Selon eux, le triomphe d’une théorie scientifique n’a pratiquement rien à voir avec son pouvoir explicatif et sa proximité avec le réel. Là encore, la figure tutélaire de Nietzsche dans ses , Fragments posthumes n’est jamais loin :
« Il n’y a pas de faits mais seulement des interprétations » (Nietzsche)
Cette thèse radicale est cependant très contestée. Sans nier l’existence de normes non épistémiques, des philosophes des sciences comme Jacques Bouveresse, Paul Boghossian ou encore Larry Laudan persistent à défendre une supériorité du principe de raison. Pour eux, si l’on n’admet pas que l’argumentation, la démonstration et l’expérimentation permettent de départager des théories scientifiques concurrentes, les controverses se réduisent alors à un simple choc des opinions où finalement toutes les idées se vaudraient. Or ce n’est pas ce que l’on observe en pratique. Tout récemment, dans Foucault et les Normes du savoir (Eliott, 2024), le philosophe français Pascal Engel entend par exemple montrer que des normes épistémiques jouent un rôle essentiel. Une hypothèse est validée parce qu’elle semble plus proche de la réalité, plus consistante ou mieux étayée qu’une autre. De fait, le relativisme n’a plus l’influence qu’il exerçait dans les années 1970 et 1980. Mais il aura eu le mérite de susciter un débat riche et fructueux.
Pour aller plus loin
Quatre définitions de la vérité
Aujourd’hui, les recherches en philosophie de la connaissance s’accordent autour de quelques grandes approches, pas forcément exclusives :
- La vérité-correspondance : c’est la conception la plus classique et peut-être la plus intuitive. Un énoncé est considéré comme vrai lorsqu’il correspond à un état de fait dans le réel. Si je dis « le chat dort sur le canapé par exemple », c’est une vérité si, en effet, un chat dort sur le canapé.
- La vérité-cohérence : certaines idées peuvent toutefois être vraies sans correspondre à une réalité matérielle, par exemple, les énoncés de mathématiques comme « 2 + 2 = 4 » ou de géométrie comme « des lignes parallèles ne se croisent jamais ».
- La vérité conventionnelle : d’autres idées sont difficiles à prouver scientifiquement, mais sont globalement reconnues comme vraies. C’est le cas de normes morales ou de justice (« la démocratie vaut mieux que le totalitarisme »), mais aussi de présupposés à la fois évidents et nécessaires à tout raisonnement (« le monde existe »).
- L’efficacité : née dans le sillage de la philosophie pragmatique américaine, c’est peut-être l’idée la moins intuitive. Un énoncé peut être considéré comme vrai s’il nous permet d’agir sur le monde avec succès. Par exemple, même si on ignore comment un médicament soigne une maladie, on peut admettre son efficacité si les statistiques la montrent sans ambiguïté.
